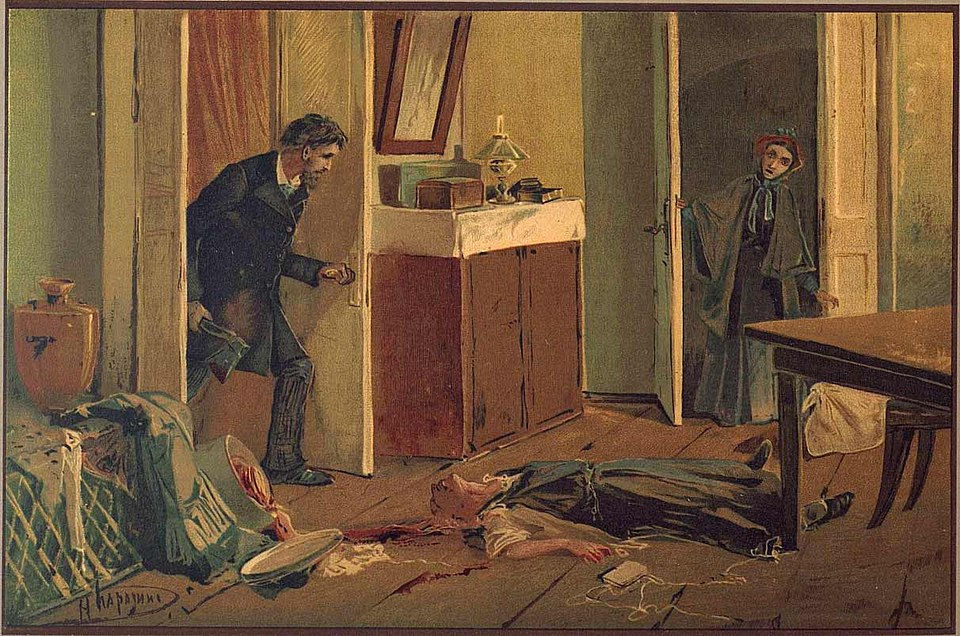
Crime et châtiment
Le crime appelle-t-il forcément le châtiment ? La chose fut peut-être vraie dans les salles d'arcade des années 80 mais l'évidence n'est décidément plus si nette. S'il n'y avait alors -presque jadis- aucun doute sur notre légitimité à triompher des nombreuses cohortes ennemies dans Ninja Gaiden ou à repousser par le glaive des hordes de gobelins dans Ghosts ‘n Goblins... qu'en est-il maintenant ? Le châtiment est-il resté une valeur phare, les jeux osent-ils toujours se reposer sur ce principe simple: quand le mal entre quelque part, il est légitime de le déloger...par la force s'il le faut ? Et peu importe les litres d'hémoglobine qui viendront se déverser à l'intérieur de l'écran! Le sang de l'ennemi étant rougeur négligeable.
A moins que, d'une certaine manière, la première victime des bornes d'arcade ne soit encore l'utilisateur lui-même... L'absence de sauvegarde l'obligeant à insérer - coûte que coûte- pléthore de pièces afin d'éviter l'affichage en pleine partie d'un frustrant "game over". Le seul châtiment quantifiable et vérifiable aurait alors été d'origine capitaliste. Mais ceci est une autre histoire...
Avec l’essor des consoles domestiques, les jeux ont commencé à intégrer un narratif plus complexe. Le mal n'est pas toujours (sinon jamais) entièrement là où on le croit. La preuve avec Vampire: The Masquerade - Bloodlines où tuer des innocents attire inexorablement une armada de chasseurs de goules qui ressemblent de fort près aux milices communautaires.
Quant au rail shooter Sin and Punishment, ce dernier explore les conséquences dues à l'hubris d'une humanité pécheresse qui voit, en retour, des forces supraterrestres déferler sur elle.
Dans les années 2010, Spec Ops: The Line a renouvelé le genre des jeux de guerre en osant une approche inédite. Les horreurs inhérentes à chaque conflit sont mises en lumière à travers les actions du joueur qui se trouve "forcé" à commettre des atrocités s'il souhaite poursuivre le jeu (la fameuse scène du phosphore blanc sur les civils ! ). Sauf qu'une fois le bouton appuyé, une séquence traumatique s'enclenche, grave, lourde de sens et qui -par son horreur graphique- vient titiller le joueur qui avait simplement (on pourrait également écrire "bêtement" ou "machinalement") pianoté sur sa manette d'un air un peu passif, croyant peut-être que ses actes seraient dépourvus de grandes conséquences sur sa psyché et sa santé mentale. Grave erreur puisque les développeurs avaient l'envie, chevillée au corps, de faire réfléchir... à grands coups d'électrochocs s'il le fallait. Le châtiment devient alors narratif: je vois des atrocités parce que j'ai cliqué pour voir des atrocités. La punition n'est plus seulement mécanique, elle est d'essence introspective et/ou contextuelle.
Des titres tels que The Witcher 3 ou Dishonored jouent, quant à eux, avec les différents degrés du relativisme moral. Dans The Witcher 3, au joueur de déterminer quel châtiment est juste ou excessif. Ne pas sanctionner un coupable amène le risque d'une récidive quand le châtier peut enclencher un pervers système de vendetta. Comment déterminer quand la réhabilitation prime sur la punition ? D'ailleurs peut-on véritablement le savoir ? Et comment appréhender ceci si l'on parvient à la conclusion que rien n'est jamais connu d'avance ?
Avec Dishonored, la solution est (faussement) plus simple: tuer ses ennemis augmente de manière irrémédiable le chaos d'un monde devenant de plus en plus hostile et désespéré dans ses manifestations. La cité devient malade de nos choix. A vouloir combattre la peste nous en charrions une autre au revers de nos semelles.
Les jeux narratifs à la manière de David Cage (Detroit Become Human, Rain….) se construisent sur d'une multiplicité de choix aux résultats tantôt immédiats, tantôt différés. Une erreur commise en début de partie peut se concrétiser quelques secondes seulement avant les crédits de fin. L'immédiateté punitive du "game over" des jeux d’arcade se déporte progressivement dans le contenu "in game". Les questionnements moraux et autres imbroglios éthiques se retrouvent piégés au sein d'une surface pixélisée.
Mais les jeux vidéo ne font que refléter les tensions à l’œuvre entre l’individu d’un côté et la société de l’autre, c'est pourquoi Papers, Please est la parfaite illustration de ce qu'est la conformité sociale. Pour faire bref, une personne est prête à sacrifier une partie (ou tout) de ses valeurs si cela peut lui éviter d'être elle-même punie. Le jeu devient ici critique envers les systèmes bureaucratiques propres aux régimes totalitaires et aux états répressifs. Le châtiment systémique qui suit les "errances idéologiques" renforce la soumission et la docilité des agents. C'est peut-être triste mais c'est un fait. Certes l'homme est un loup pour l'homme mais il est également chihuahua tremblotant comme gelée en boîte.
À l’autre bout du spectre (au sein des nations dites démocratiques) d'autres horreurs flottent à la surface. Ainsi L.A. Noire place le joueur dans la peau d’un détective californien (plus précisément quelque part dans la sulfureuse Los Angeles des années 1940) devant enquêter sur plusieurs affaires aussi sordides les unes que les autres. Mener un interrogatoire trop "poussé" peut mener au fiasco mais ne pas assez "secouer " son suspect n'est guère plus une solution viable au point de vue de la rentabilité des dossiers. La balance entre désir de justice et préservation éthique oscille bien souvent d'un plateau à l'autre. En fonction des cas, des humeurs ou d'un rien...
Dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, tuer enclenche un mode "vengeance" : des renforts apparaissent et rendent l’infiltration plus ardue. Ce mécanisme de gameplay illustrant presque la théorie du contrôle social: la déviance individuelle (violence excessive de l'individu) viendrait perturber l'entièreté de la collectivité.
Le jeux vidéo permet de critiquer -de manière plus ou moins explicite- la reproduction des cycles de violence. Le thème est d’autant plus pertinent qu'il s'inscrit dans une époque de prolifération des conflits armés partout à travers le monde. Toujours dans la saga Dishonored, multiplier les attaques létales intensifie le chaos; les rats prolifèrent et les rondes se font de plus en plus fréquentes. L'anarchie (aussi) a un prix. Choisir la voie de la vengeance engendre des répercussions sur l'ensemble de la société. Un vengeur masqué n'est jamais isolé, il reste relié à la cité.
Dans Frostpunk, le joueur est placé au sein d’une dystopie où certains choix (telle l'exécution des dissidents) servent à maintenir -bon gré, mal gré- l’ordre… au prix de la moralité! A quoi peut donc bien servir la justice si celle-ci ne sert qu’à renforcer l’autorité ?
Moins manichéen dans son traitement, penchons nous un instant sur This War of Mine où le simple fait de dérober des ressources nécessaires à notre propre survivre peut nous pousser au suicide. Je respire encore parce que j'ai volé la nourriture d'autrui, mérite-je vraiment de vivre ?
Au fond qu’en conclure sinon que ces jeux ne servent qu'à mettre en valeur une tension déjà existante à l'intérieur de nos sociétés: choisir la voie répressive ou tenter une approche davantage "bienveillante" ?


